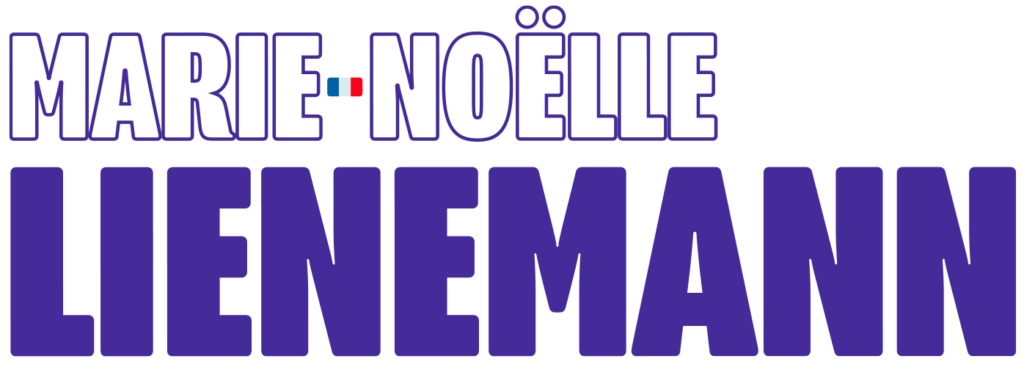Les « plans sociaux », les fermetures d’usines se multiplient. Il faut dire que bon nombre de ces décisions ont été différées après les présidentielles et sont les dramatiques conséquences de 10 ans de politique de droite et de désindustrialisation du Pays. Le redressement productif est la priorité absolue. Nous savons qu’il faudra du temps pour remonter la pente. Mais cependant certaines décisions sont d’une urgence extrême, car toute activité qui ferme ne sera pas ouverte de sitôt et risque même de ne plus pouvoir s’implanter en France. Voilà l’urgence !
Les « plans sociaux », les fermetures d’usines se multiplient. Il faut dire que bon nombre de ces décisions ont été différées après les présidentielles et sont les dramatiques conséquences de 10 ans de politique de droite et de désindustrialisation du Pays. Le redressement productif est la priorité absolue. Nous savons qu’il faudra du temps pour remonter la pente. Mais cependant certaines décisions sont d’une urgence extrême, car toute activité qui ferme ne sera pas ouverte de sitôt et risque même de ne plus pouvoir s’implanter en France. Voilà l’urgence !
Des mesures défensives :
– Vote immédiat d’une loi pour obliger les reprises lorsqu’un repreneur crédible existe.
– Vote immédiat d’une loi pour empêcher les licenciements économiques abusifs (licenciements boursiers), les socialiste et les communistes, les verts s’étaient mis d’accord sur des dispositions en ce sens, suite à la jurisprudence VIVEO.
– Vote immédiats de nouvelles dispositions permettant la reprise par les salariés sous forme de SCOP (droit de priorité, statut de la forme transitoire de coopérative d’actionnaires minoritaires etc..)
Voilà plusieurs mois que j’alerte le gouvernement sur ces absolues priorités. L’argument qui m’est opposé est la nécessité de la négociation sociale. Mais en attendant, les fermetures se bousculent, les salariés ont le sentiment de notre impuissance. On ne peut plus différer.
Mais dans certains cas, il faut aller plus loin encore, en envisageant des nationalisations fussent-elles transitoires.
IL faut tout d’abord remarquer que les privatisations de bon nombre de nos industries ont été une véritable catastrophe pour la France. Il suffit de vois ce qu’il reste de ces grands secteurs que nous avons privatisé pour mesurer les dégâts (chimie, aluminium, santé, acier etc…). Souvent, des comparaisons sont faites avec l’Allemagne, essentiellement sur le cout du travail et sur les rapports sociaux. On oublie un élément essentiel : chaque peuple a son génie propre son histoire, sa culture. En France, depuis très longtemps, mais plus encore après la seconde guerre mondiale, l’Etat a joué un rôle économique et industriel majeur, en particulier à travers du capital public. En Allemagne, ce fut l’intervention des banques régionales, la tradition du capitalisme familial à laquelle s’est ajoutée après la guerre, la cogestion. Mais lorsque les libéraux, et parfois au sein même de la gauche ont imposé les privatisations, nos entreprises sont devenues hyper vulnérables aux fonds étrangers, et tout particulièrement aux fonds de pension dont la rentabilité capitalistique à court terme, le niveau des dividendes versés constituent la priorité absolue. Pendant ce temps-là, les entreprises Outre-Rhin demeuraient sous un fort contrôle allemand. Inutile de dire que ces entreprises ont moins délocalisé que dans notre pays.
Il faut dans certains cas frapper fort. Et dans le cas d’Arcelor, Florange ou dans le cas de Pétroplus, si aucune reprise n’est envisagée, il faut procéder à des nationalisations. Dans certains cas, il pourra s’agir de nationalisations temporaires, avant de retrouver un repreneur fiable et s’engageant à rester en France. Dans le cas de Florange, la nationalisation devra s’accompagner d’une réflexion stratégique de l’avenir de la filière acier en France et sans doute de soutenir des recherches pour que nous ne prenions aucun retard technologiques dans les aciers spécialisés. Dans le cas de Pétroplus, on pourrait attendre des grands pétroliers qui paient peu d’impôts en France et bénéficient souvent des liens étroits que notre pays peut nouer avec certains territoires pour y développer leurs interventions soient attentifs à soutenir le raffinage sur notre sol.
On dira que ces nationalisations coutent chers. Pas Sûr puisqu’il faudrait – parait-il – les fermer.
Et là on voit que le débat sur l’austérité n’est pas un débat abstrait. Est-il plus urgent d’aller à marche forcée, et à tout prix, vers la réduction des déficits à 3% dès cette année ou d’engager une véritable politique de redressement productif en investissant pour l’avenir ?
Ma réponse est claire, c’est la seconde position qui est déterminante.
Une stratégie offensive, et c’est tout l’enjeu de la création de la Banque publique d’investissement.
L’idée est importante, mais il ne faudrait pas la discréditer en se contentant d’organiser un mécano qui regroupe les structures existantes sans injecter massivement des fonds, sans utiliser cet argent public de manière radicalement différente des interventions actuelles.
On peut s’inquiéter des annonces de Jean-Marc Ayrault, à l’issue d’une réunion de ministres indiquant que la capacité financière de la BPI serait de l’ordre de 30 milliards d’euros, soit une somme à peine supérieure à l’addition des actifs détenus par les entités regroupées. En clair, les seuls moyens nouveaux de la BPI proviendraient de certains apports permis par le doublement du plafond prévu du Livret de développement durable (LDD, l’ex-Codevi).
Si cette décision devait en rester là, la BPI qui va voir le jour risquerait d’être un simple effet de communication sans changer la donne en matière de financement de l’économie.
Il faut que le congrès du PS oblige à un débat public sérieux sur les moyens et l’usage de cette nouvelle banque. Car une fois de plus, le très puissant ministère de l’économie et des finances, en l’occurrence la direction du trésor est très tentée de faire échouer un projet qu’elle n’a jamais admis. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle traine des quatre fers, sous des gouvernements différents. Elle avait obtenu que soit enterrées de nombreuses études sur des outils financiers publics pour booster l’investissement en France. La dernière en date, en janvier 2012, proposait un choc public massif de 250 à 300 Milliards pour créer un choc d’investissement, plus utile pour la compétitivité que celui que provoquerait la baisse du cout du travail ou la purge budgétaire. Pour atteindre ces sommes, il faut une politique volontariste visant à orienter l’épargne des Français , en particulier l’assurance vie, en direction de cet outil.
C’est l’objectif qu’il faut viser !
Il convient aussi de bien clarifier ce que l’on attend de la banque publique d’investissement. Elle doit tout à la fois soutenir des filières industrielles à consolider ou à faire émerger, en particulier dans les nouvelles technologies où celles qui sont en rapport avec la transition énergétique, mais aussi des secteurs stratégiques, mais elle doit aussi soutenir les PME et cela en lien avec les régions. Faut-il encore que les critères de la BPI ne soient pas la stricte reproduction des critères habituels des banques.
Il est essentiel que les interventions de la BPI ne soient pas seulement des prêts, mais soient le plus souvent possible versées sous forme de capital, permettant de garantir assez durablement le maintien de l’activité sur le territoire national. De surcroit le capital est rémunéré, même modestement et constitue un actif et non une simple dépense budgétaire. Enfin, justement il est important de soutenir les entreprises rentables, même si la rentabilité n’atteint pas les 14 à 15%. Or ce seuil est souvent ce qui condamne des entreprises viables.
Ainsi, nous ne devons pas laisser la banque publique d’investissement n’être qu’une simple holding de tête, regroupant des organismes déjà existants, dont le Fonds stratégique d’investissement (FSI), Oséo, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, CDC Entreprises et UbiFrance. Faisons de cet enjeu un vrai débat public. La motion 3 Maintenant la gauche prend position. Depuis sa rédaction, le dossier avance, mais pas dans la bonne direction. Réagissons !
|